Dans son dernier livre, Anne Alombert, Maîtresse de Conférences à l’Université Paris 8, invite le lecteur à réfléchir sur l’impact de la diffusion exponentielle de l’intelligence artificielle générative sur notre condition humaine (langage, culture, environnement).
Par-delà les fantasmes d’une intelligence artificielle qui détruirait l’humanité lors d’un combat de science-fiction entre machines et humains, cet essai démontre que l’intelligence artificielle est avant tout un processus d’automatisation qui altère les savoirs humains. A une échelle plus globale, l’utilisation de l’intelligence artificielle générative a déjà démontré son potentiel de déstabilisation de nos démocraties. De plus en plus de voix dénoncent la concentration du pouvoir au sein d’une oligarchie libertarienne qui s’enrichit sur l’appauvrissement de nos ressources humaines.
L’IA générative : une nouvelle révolution industrielle régressive
La révolution industrielle a transformé le savoir-faire des artisans en un savoir-faire automatisé qui aliène ceux qui surveillent les machines. La révolution actuelle avec la propagation de l’intelligence artificielle transforme les savoir-penser en automatisation numérique. L’étudiant ne prend plus le temps de travailler son esprit d’analyse et de synthèse mais, dans le meilleur des cas, vérifie la réponse fournie par ChatGPT. L’auteure cite une étude du Massachusetts Institute of Technology qui compare plusieurs groupes de personnes rédigeant un essai avec ou sans ChatGPT. L’usage de ce dernier induit une réduction de la connectivité cérébrale et de l’amplitude cognitive. Nous serions donc au début d’une décadence de l’esprit humain en faisant travailler les machines à notre place.
Le Siècle des Lumières est un lointain passé qui laisserait la place au Siècle des Automates, privant la place publique des subtilités des débats. En effet, les algorithmes générés sur les plateformes numériques (X, Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube, etc.) visent à promouvoir des contenus clivant qui sont proches de la pensée de l’utilisateur. L’IA décide à notre place quel contenu nous pouvons voir. Ainsi, la nuance s’efface pour laisser place à une bataille binaire. L’objectif n’est pas d’atteindre la vérité mais d’atteindre le maximum de « likes ». L’auteure compare les algorithmes à des sophistes modernes qui répètent comme des perroquets sans comprendre le fond de la pensée. A force d’imiter les perroquets, nous deviendrons nous-mêmes des perroquets. Notre singularité, notre histoire, nos traditions et nos représentations seront remplacées par une uniformisation de la pensée pilotée par une oligarchie autocentrée sur ses valeurs.
L’IA générative : une intelligence extractive
Comme les industries pétrolières, l’intelligence artificielle a besoin de réaliser de nombreuses extractions pour fonctionner. L’intelligence artificielle a besoin d’une ribambelle de données pour produire des contenus. Ces données sont stockées dans des Data Centers qui ont besoin d’une quantité immense d’énergie et d’eau. Google et Microsoft ont augmenté leur consommation d’eau, respectivement de 20% et 34% entre 2020 et 2023 ; Amazon, quant à elle, dispose d’une centrale nucléaire pour alimenter certains de ses serveurs. Les ressources naturelles que l’on souhaite protéger sont pillées par l’utilisation de l’IA générative.
Par ailleurs, via les algorithmes ciblés, l’IA transforme les utilisateurs en consommateurs passifs. L’usage gratuit des plateformes est monétisé par la diffusion massive de publicités ciblées selon les préférences des utilisateurs. En scrollant sur les plateformes inondées de publicités, les usagers nourrissent le capitalisme computationnel et enrichissent une poignée d’entreprises qui créent des algorithmes lucratifs (OpenAI est valorisé en bourse à 500 milliards de dollars, dépassant SpaceX).
L’IA générative : je prompte donc je suis ?
Grâce aux prompts, les intelligences artificielles génératives « créent » des sons, textes, images et vidéos. La création artistique va-t-elle être détruite au profit d’une commande à une intelligence artificielle ? L’auteure réalise une analogie entre la commande d’un fast-food (ou d’une commande artistique auprès de l’IA) et la création d’un repas maison (création d’un artiste qui cherche à interpeller). Ce fast-think computationnel a les mêmes conséquences que les fast-food : homogénéisation des saveurs dans un cas, des pensées dans l’autre, dégradation de la qualité des aliments/de la pensée, coût moindre pour le consommateur au prix d’une destruction de l’environnement, prolétarisation des employés, etc…
Notre singularité qui permet de penser, de réfléchir à partir de nos expériences est en train d’être remplacée par une logique totalitaire numérique qui est prescrite par une minorité. Aucune régulation digne de ce nom n’existe autour du déploiement de l’intelligence artificielle générative. A l’inverse d’un médicament qui doit réaliser des essais cliniques et demander des autorisations de mise sur le marché, les applications se développent sans aucun garde-fou. L’auteure illustre la menace de l’application directe de l’IA : « La start-up Replika fournit des « compagnons » virtuels à des clients qui peuvent configurer un avatar numérique adapté à leurs besoins, avec lequel ils pourront échanger jour et nuit, à l’oral et à l’écrit. […] Plutôt que de remédier à la solitude, les compagnons virtuels pourraient bien déposséder les individus de leur « savoirs sociaux » fondamentaux comme leur savoir-vivre ou leur savoir-aimer. » Je prompte donc je suis ?
Qu’apporte vraiment l’intelligence artificielle générative ? Un compagnon virtuel ? Des publicités ciblées ? Un gain de temps pour écrire ? Un gain de temps pour créer ? Un gain de temps pour analyser ? N’est-il pas temps de sortir de la bêtise artificielle et de remettre la technologie au service de l’intérêt général ? L’essai d’Anne Alombert est à lire pour celles et ceux qui souhaitent penser par eux-mêmes et comprendre la bêtise dans laquelle on s’engouffre en laissant les calculs diriger tous les pans de nos vies.
« De la bêtise artificielle », Anne Alombert, éditions Allia, sept. 2025
Recension de Mme Sophie Rousseau, cheffe de projet en Santé publique
En savoir plus sur AFCIA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
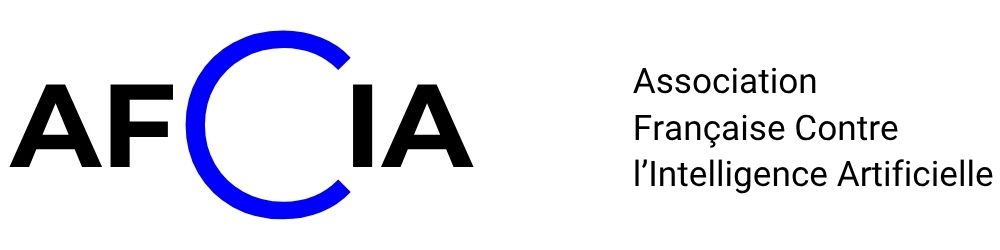
La robotique et l’IA : cela vous plairait de vous balader dans la rue et interragir avec des individus sans pouvoir distinguer un être humain d’un robot ?
Il faut absolument un moratoire sur ces développements déjà fort avancés.
L’IA est une technologie extraordinaire mais il faut lui appliquer des règles de comportement, des garde-fous qui seront réellement appliqués afin d’essayer d’en garder le contrôle en toute transparence. Tout ce qui concerne l’IA doit être totalement Open Source.
Les développeurs courent tous vers l’IAG et protègent plusieurs parties de leur code et leurs méthodes.